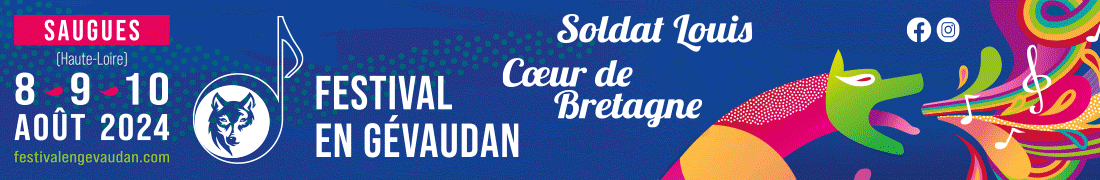« Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde », écrivait Albert Camus dans une étude intitulée « Sur une philosophie de l'expression », publiée en 1944. Et rien de tel que d’étudier les LCA (langues et cultures de l’antiquité) et les LCE (langues et cultures européennes), deux enseignements prodigués au collège public des Gorges de la Loire, pour apprendre à « bien nommer ».
C’est dans ce dessein que, en cette fin mai 2024, les latinistes du collège public des Gorges de la Loire, accompagnés des élèves étudiant les LCE anglais, ont enfilé leur sac à dos, une paire de jumelles et… des vêtements imperméables pour partir à la découverte des sciences du vivant et du langage, guidés par leurs enseignant·es d’anglais, d’histoire et de latin, et de la « passeuse de nature » Marine Schmitt.
Quand les élèves appréhendent la nomination du vivant pour mieux le comprendre
Pour préparer ce travail, les élèves travaillaient depuis plusieurs semaines sur le latin de nos jardins. Comprendre pourquoi une coccinelle est appelée Coccinella septempunctata et une autre Coccinella undecimpunctata ou encore Propylea quatuordecimpunctata ; saisir pourquoi le « ventre-pied » préféré des Français, notre gastéropode de Bourgogne, est appelé « Helix pomatia » ; élucider le rapport entre la « Luciola lusitanica », une matière translucide, et le prénom Lucie ; faire le lien entre l’ « Apis mellifera » et celle ou celui qui cultive son miel… Il était alors aisé de comprendre que le latin, langue de l’Église de Rome, religion universelle et langue universelle, langue des érudits et des scientifiques, était la langue la plus à même de nommer et d’éviter les incompréhensions.
Quand les élèves observent pour bien nommer
« Nous sommes issus du cosmos, de la nature, de la vie, mais du fait de notre humanité même, de notre culture, de notre esprit, de notre conscience, nous sommes devenus étrangers à ce cosmos qui nous demeure secrètement intime » écrivait Edgar Morin pour l’UNESCO en 1999 dans Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur. Ainsi, savoir nommer ce qui tombe sous notre observation oblige à ne pas être étranger au milieu dans lequel nous évoluons ; c’est ainsi que le latin, souvent présenté comme une langue morte, est plus que vivant puisque grâce à lui et dans le cadre de cette journée étymo-scientifique, les élèves ont appris à regarder, observer ce vivant pour mieux le nommer et le comprendre : observer le moment de la floraison et la longévité de la plante, observer l’origine, la géographie et le biotope et ainsi comprendre que la « Mentha aquatica » pousse en milieu humide et le « Leymus arenarius » dans le sable, que l’ « Anthriscus sylvestris » est plus connu sous le nom de cerfeuil des bois, un ombellifère omniprésent en Haute-Loire dont les élèves ont pu observer les ombelles, la « Malva sylvestris » sous le nom de mauve sauvage ; quant au « Trifolium pratense » et au « trifolium repens », très mellifères, il s’agit du trèfle constitué de trois feuilles… parce que, depuis Carl von Linné, l’on nomme aussi une plante en fonction du nombre de ses feuilles, de ses fleurs, de leur taille, de leur largeur, de leur forme, de leur couleur, de leurs qualités. Ainsi, au cours de leur marche dans les sous-bois d’Aurec-sur-Loire, les élèves ont pu observer le « Lamium album » (blanc comme l’aube et l’albumine) et le « Lamium purpureum, mais aussi l’ « Hedera helix », ce lierre grimpant qui s’entortille comme une hélice autour des arbres, ou encore le « Sanguisorba minor » autrement connu sous le nom de « petite pimprenelle » aux fleurs… rouges, que les élèves ont pu goûter car nommer permet aussi de reconnaître, d’être attentif aux interactions et… d’utiliser.
Savoir reconnaître pour mieux utiliser
Entre deux averses, les élèves ont parcouru le sentier botanique et, durant cette déambulation, Mme Schmitt s’est non seulement évertuée à leur ouvrir les yeux sur la nomination des plantes mais aussi à stimuler leurs papilles. En effet, l’autre objectif de cette sortie, c’était l’hortithérapie, comprenez le « bien-être » par les plantes, car les plantes sauvages ont des vertus souvent méconnues : elles peuvent être comestibles (du latin « cum-edere » signifiant manger) et curatives (du latin « curare » signifiant soigner). Après s’être amusés avec du gaillet-gratteron et avoir observé ses petits crochets, les élèves ont donc cueilli, en les saisissant prudemment par-dessous, les feuilles sommitales de l’ « Urtica dioica », les ont froissées et… goûtées (car oui, l’ortie se savoure aussi crue !) ; néanmoins, celles et ceux qui se sont piqué·es ont ensuite cueilli des feuilles de « Plantago major » (grand plantain) voire, mieux, de « Plantago lanceolata » (plantain lancéolé), les ont froissées et… appliquées sur les piqûres : un excellent anti-inflammatoire et antiseptique ! Pendant ce temps, d’autres découvraient que le lamier pouvait remplacer, dans une salade ou une omelette… les champignons, et que la pimprenelle, au goût de concombre, avait des vertus digestives !
Réinvestir pour mieux retenir
Tant qu’à être en pleine nature, les élèves ont également profité des compétences en ornithologie de Marine Schmitt pour mieux mettre leurs oreilles en paraboles et entendre le chant de l’ « Erithacus rubecola » (votre latin vous aura permis de reconnaître le rouge-gorge familier !), pour mieux observer la couleur, la queue, les ailes et la gorge des hirondelles et apprendre à distinguer l’hirondelle des fenêtres de l’hirondelle rustique mais aussi du martinet, ainsi que l’échancrure, les digitations (du latin « digitus » doigt) et les panneaux alaires (du latin « ala » aile) du milan royal et du milan noir. De la même manière que les plantes, les animaux sont nommés… en latin ! D’ailleurs, c’est un sympathique « Canis lupus familiaris » qui a accompagné les élèves toute la journée ! Et l’après-midi s’est achevé sur un remue-méninges de tout ce qui avait été vu, appris, compris durant la promenade, et la création d’herbiers latino-anglais, avec la description des plantes et leur nomination scientifique (genre-espèce), sans oublier l’explication de cette nomination.
Ainsi, cette sortie botanique, zoologique et étymologique, soutenue et entièrement financée par le rectorat, avait pour ambition de donner accès à une certaine intelligibilité du monde et d’ouvrir les yeux des élèves en espérant leur procurer des connaissances et plaisirs nouveaux pour les inciter à découvrir davantage encore par eux-mêmes ; car comme le dit Hubert Reeves, cité par B. Pellequer dans le Petit guide du ciel, « reconnaître les étoiles, c’est à peu près aussi utile (ou inutile…) que de savoir nommer les fleurs sauvages dans les bois. […] La vraie motivation est ailleurs. Elle est de l’ordre du plaisir. Le plaisir de transformer un monde inconnu et indifférent en un monde merveilleux et familier. » Ce sont ces « mirabilia » et cette familiarité que pousse à retrouver l’enseignement des LCA et des LCE au collège public des Gorges de la Loire.